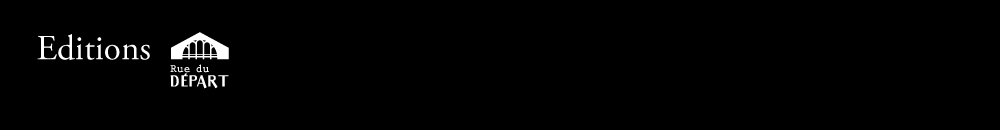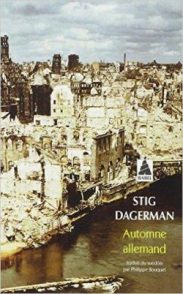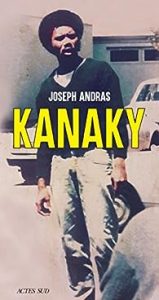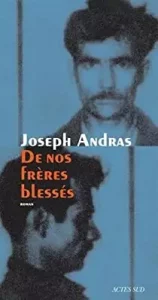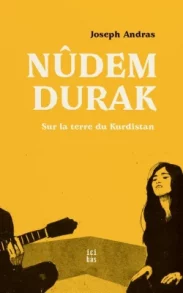A l’émission Midi-culture, sur France-Culture, le 6 septembre :
 coup de gueule de Fatou Diome :
coup de gueule de Fatou Diome :
et sujet de » l’essai flamboyant, drôle et imagé qu’elle publie en cette rentrée chez Albin Michel ».
« Le verbe libre ou le silence : dans cet essai qui prend la forme d’un plaidoyer pour la liberté des écrivains et contre les diktats imposés par certains professionnels de l’édition, Fatou Diome est catégorique. Les éditeurs ne peuvent interférer dans le processus créatif des auteurs puisque celui-ci relève de l’expression d’une intimité et d’une subjectivité qui leur est propre. »
——————————
Je fais un lien avec une émission qui m’avait hérissée il y a quelque temps sur cette même radio – sans pouvoir, désolée, la retrouver – où une écrivaine et son éditrice parlaient. L’éditrice donnait ses conseils / ordres et ,clairement, ça simplifiait un maximum, influait sur le fond comme sur la forme et avait pour but que « le produit » soit simplifié, se vende plus sûrement, pas pour faire progresser la littérature.
Entre ça et Chatgpt, peu de différence …