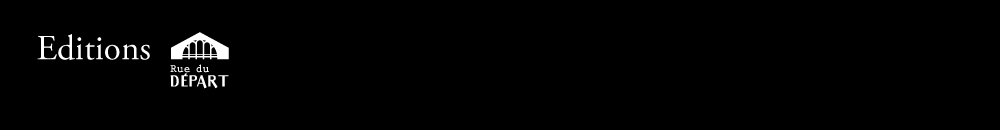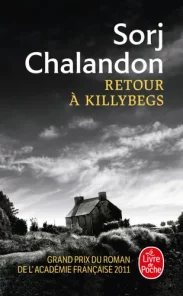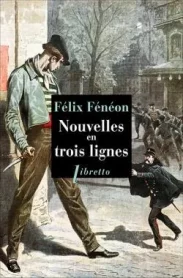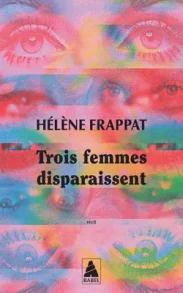Encore un premier !
Encore un premier !
A croire que je ne lis pas !
L’heure de la sensation vraie de cet auteur autrichien a été publié en Allemagne en 1975, en France, chez Gallimard en 1977. Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt.
 Cela a été porté à l’écran en 1988 sous le titre Ville étrangère par Didier Goldschmidt, fils du traducteur, avec Niels Arestrup dans le rôle principal.
Cela a été porté à l’écran en 1988 sous le titre Ville étrangère par Didier Goldschmidt, fils du traducteur, avec Niels Arestrup dans le rôle principal.
Gregor Keuschnig est un homme arrivé, attaché de presse à l’ambassade d’Autriche à Paris.
Il vit deux jours dans une sorte de crise, en homme clivé … et plutôt désagréable, entre autres avec les femmes… Crise professionnelle, familiale, personnelle qui aboutit à un possible nouveau départ, moins fabriqué, plus en phase avec ses origines.
Quelques Poèmes Express issus de ce Peter Handke :
– On entend un coup de frein mais remarqué trop tard sans regarder.
– Il n’existe pas d’obligation de continuer à vivre, chairs et tendons.
– Tout était misérablement normal. Quotidien, ce qui lui faisait du bien.
– La rame roulant plus lentement le long d’un chantier, il vit tous ces visages.
– Il pensa à comment il avait couché avec elle, mains, hanches, sans sentiment.
– Un fantôme dépose plainte contre ce monde au lieu de disparaître.
– Dans l’immeuble en face, une femme, cuisses et seins, derrière la vitre.
– Il n’allait pas se raconter d’histoire : fini de se montrer nu.
– Il sentit sa propre sueur. puis d’une femme élégante – chacun révélait qu’il vivait –