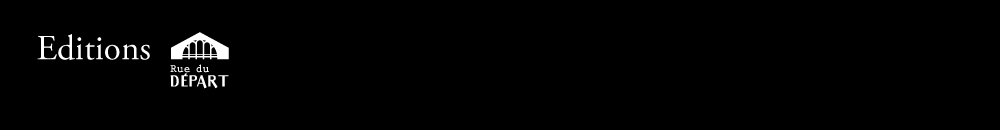Notes à propos de Jean-Pierre Mocky et de quelques adaptations de romans policiers par des cinéastes contemporains de la Nouvelle Vague.
Comme les cinéastes phares de la Nouvelle Vague, Truffaut, Chabrol, Godard, Jean-Pierre Mocky était lecteur assidu de romans policiers. Claude Chabrol en fit une de ses marques, au même titre que la bonne chère ou la convivialité. Il abordait volontiers ce sujet dans ses interviews et couronna cette expertise d’un titre de directeur de collection auprès de son complice François Guérif, expert en la matière.
La collection » Série noire » devint rapidement dans les années 50 un signe de reconnaissance culturel et la préférée de la plupart de ces jeunes cinéastes, au point d’apparaître, avec sa couverture facilement identifiable, dans leurs films, qu’ils relèvent on non du genre policier. A coté des adaptations distanciées de Chabrol, Truffaut, Godard, des réalisateurs de la même génération mais n’appartenant pas à la vague officielle (malgré des préoccupations parfois très proches : attention à la jeunesse, ton et forme plus “frais”… ), tels Michel Deville ou Jean-Pierre Mocky portèrent à l’écran bon nombre de polars en se réclamant gros lecteurs du genre. Deville, ancien assistant de Decoin (lequel adapta Simenon, Jacques Robert, Auguste Le Breton, Boileau-Narcejac), revisita les univers de Pierre Lesou (irrégulier de la « Série noire « ) avec Lucky Jo, Roger Blondel (irrégulier tout court, auteur de S.F. au Fleuve noir) avec Le Mouton enragé, René Belletto (lui-même décrypteur du genre) pour Péril en la demeure, voire le méconnu mais apprécié des amateurs Franz Rudolph Falk avec son Paltoquet ; à côté de la très célébrée Patricia Highsmith (Eaux profondes) il braqua le projecteur sur le trop peu lu Andrew Coburn grâce à sa magnifique adaptation, Toutes peines confondues. A l’instar de ses cousins de la Nouvelle Vague et à la différence de son ancien patron Decoin, Michel Deville utilisa le matériau de ces romans pour le refondre en un métal plus incisif, moins fruste aux yeux d’un public qui se renouvelait et devenait plus exigeant. Il appréciait réellement ces auteurs mais considérait, comme Truffaut, qu’il était nécessaire de les renouveler, et surtout de se les approprier (voir l’interview télévisée de ce dernier à la sortie de Tirez sur le pianiste). Les deux réalisateurs eurent recours à un humour décalé ou primesautier (Tirez sur le pianiste, Lucky Jo) mais surent adopter un ton plus grave (La Sirène du Mississipi, Eaux profondes, Toutes peines confondues).
Prochainement au programme du Studio (du 12 au 25 novembre), en partenariat avec Les Ancres noires (séance du vendredi 14, 20h30).
Notes à propos de Jean-Pierre Mocky et de quelques adaptations de romans policiers par des cinéastes contemporains de la Nouvelle Vague.Comme les cinéastes phares de la Nouvelle Vague, Truffaut, Chabrol, Godard, Jean-Pierre Mocky était lecteur assidu de romans policiers. Claude Chabrol en fit une de ses marques, au même titre que la bonne chère ou la convivialité. Il abordait volontiers ce sujet dans ses interviews et couronna cette expertise d’un titre de directeur de collection auprès de son complice François Guérif, expert en la matière.La collection » Série noire » devint rapidement dans les années 50 un signe de reconnaissance culturel et la préférée de la plupart de ces jeunes cinéastes, au point d’apparaître, avec sa couverture facilement identifiable, dans leurs films, qu’ils relèvent on non du genre policier. A coté des adaptations distanciées de Chabrol, Truffaut, Godard, des réalisateurs de la même génération mais n’appartenant pas à la vague officielle (malgré des préoccupations parfois très proches : attention à la jeunesse, ton et forme plus “frais”… ), tels Michel Deville ou Jean-Pierre Mocky portèrent à l’écran bon nombre de polars en se réclamant gros lecteurs du genre. Deville, ancien assistant de Decoin (lequel adapta Simenon, Jacques Robert, Auguste Le Breton, Boileau-Narcejac), revisita les univers de Pierre Lesou (irrégulier de la « Série noire « ) avec Lucky Jo, Roger Blondel (irrégulier tout court, auteur de S.F. au Fleuve noir) avec Le Mouton enragé, René Belletto (lui-même décrypteur du genre) pour Péril en la demeure, voire le méconnu mais apprécié des amateurs Franz Rudolph Falk avec son Paltoquet ; à côté de la très célébrée Patricia Highsmith (Eaux profondes) il braqua le projecteur sur le trop peu lu Andrew Coburn grâce à sa magnifique adaptation, Toutes peines confondues. A l’instar de ses cousins de la Nouvelle Vague et à la différence de son ancien patron Decoin, Michel Deville utilisa le matériau de ces romans pour le refondre en un métal plus incisif, moins fruste aux yeux d’un public qui se renouvelait et devenait plus exigeant. Il appréciait réellement ces auteurs mais considérait, comme Truffaut, qu’il était nécessaire de les renouveler, et surtout de se les approprier (voir l’interview télévisée de ce dernier à la sortie de Tirez sur le pianiste). Les deux réalisateurs eurent recours à un humour décalé ou primesautier (Tirez sur le pianiste, Lucky Jo) mais surent adopter un ton plus grave (La Sirène du Mississipi, Eaux profondes, Toutes peines confondues).